La Cour de Cassation donne raison à Free sur la subvention des téléphones portables
L’opérateur avait engagé un bras de fer en 2012 avec SFR à propos du paiement étalé du prix des appareils proposé dans le cadre de ses forfaits « Carré ».
Free a remporté son combat contre SFR. Six ans après avoir été saisie par l’opérateur de Xavier Niel, la Cour de cassation a rendu mercredi un arrêt lui donnant raison sur la subvention des téléphones mobiles.
Dans cet arrêt du 7 mars, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a estimé que le paiement étalé des téléphones portables, proposé par tous les opérateurs télécoms (sauf Free) en échange d’une période d’engagement plus longue, est une facilité de paiement « déguisée » et donc… une forme de crédit à la consommation. Sans être illégales, ces offres doivent malgré tout obéir au code de la consommation, a prévenu la Cour.

« Le principe de la subvention n’est pas remis en cause en soi. Ce n’est pas le grand soir, mais c’est tout de même un pas appréciable envers la transparence » estime Antoine Autier, de l’association UFC-Que Choisir. L’organisation milite depuis longtemps contre ces offres couplées qui, selon elle, « enferment » les clients dans un contrat pendant une longue période. « Les consommateurs pensent souvent faire une bonne affaire, mais selon nos études, il y a un surcoût, qui fait qu’in fine ils peuvent payer leur téléphone 50 % plus cher », selon l’organisation de défense des consommateurs.
Les opérateurs rappellent, de leur côté, que leurs abonnés peuvent à tout moment faire évoluer leur contrat. Et que ces subventions permettent d’atteindre, à l’échelle d’un pays, un taux d’équipement mobile élevé. En France, les contrats mobiles avec téléphone subventionné représentent encore plus de 33 % du volume, selon l’Arcep, contre plus de 83 % en 2012, lorsque Free a déboulé sur le marché, avec son modèle « SIM-only » (sans appareil) et ses offres à prix cassés.
Offre « Carré »
Free a fait les calculs et selon la société, certains forfaits mobiles souscrits par des millions de Français auprès des autres opérateurs pourraient dorénavant être caducs. Potentiellement, Free estime pouvoir toucher « un marché supplémentaire de 17 millions d’abonnés engagés dans ce type de forfaits. » « C’est une partie du marché qui nous échappait intégralement, et là, elle a été brutalement ouverte », se réjouit-on chez Free.
En réalité, cela ne serait pas aussi simple que cela. Les opérateurs vont en effet devoir examiner, au cas par cas, la conformité de leurs offres avec l’arrêt de la Cour. En privé, Bouygues, Orange et SFR minimisent tous les trois la portée du jugement. « Nous l’étudions attentivement pour évaluer les impacts éventuels », dit-on notamment chez Bouygues Telecom.
À ce stade, l’arrêt est surtout un caillou de plus dans les chaussures de Patrick Drahi, qui doit présenter, la semaine prochaine, les résultats annuels de SFR, qui traverse une période de turbulences.
L’opérateur est au centre de l’affaire : entre juin 2011 et septembre 2012, SFR avait commercialisé ses offres « Carré » permettant d’acquérir un téléphone portable, soit à un prix « de référence », soit à un tarif « attractif ». Dans ce dernier cas, le forfait mobile était plus cher pendant 12 ou 24 mois, après quoi l’abonnement repassait au prix de base.
À l’époque, Free, qui venait de débouler sur le marché, avait saisi la justice, estimant que cette dernière formule s’apparentait à une opération de crédit et constituait une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis des consommateurs. « On a ciblé SFR car il s’agissait d’une offre particulièrement caricaturale, mais on aurait pu s’attaquer à n’importe qui d’autre » explique Free.
En première instance puis en appel, les juges avaient d’abord donné raison, sur le fond, à SFR. La Cour de cassation, qui se prononce sur la forme, s’est rangée, elle, du côté de Free. L’affaire est en tout cas loin d’être terminée et va repartir en Cour d’Appel de renvoi.
La réforme de la formation professionnelle avance..
La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a présenté les grandes lignes de sa réforme de la formation professionnelle quelques jours seulement après la conclusion par les partenaires sociaux d’un accord national interprofessionnel sur le sujet…

Les étapes de la réforme
Lancée à l’automne dernier par le Gouvernement, la réforme de la formation professionnelle a franchi deux nouvelles étapes.
Tout d’abord, les partenaires sociaux ont conclu le 22 février un accord national interprofessionnel (ANI) pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance ; cet accord a été signé par toutes les organisations patronales et syndicales, sauf la CGT.
C’est ensuite la ministre du travail, Muriel Pénicaud, qui a présenté le 5 mars les principes directeurs de sa réforme visant à transformer en profondeur le système de la formation professionnelle en France.
À noter : l’étape suivante de la réforme passe par la présentation en Conseil des ministres, vraisemblablement dans le courant du mois d’avril, d’un projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui intégrera, outre la réforme de la formation professionnelle, deux autres grands volets consacrés à l’apprentissage et à l’assurance chômage.
S’éloignant quelque peu des préconisations inscrites dans le document d’orientation qui leur avait été remis par le Gouvernement il y a quelques mois, les partenaires sociaux ont annoncé plusieurs mesures emblématiques, notamment sur le compte personnel de formation (CPF) et le financement de la formation. De son côté, la ministre du travail, déçue par le contenu de l’ANI, est allée bien plus loin, notamment en matière de gouvernance nationale de la formation.
Le contenu de l’ANI
Les principales mesures de l’ANI sont les suivantes :
– le compte personnel de formation serait renforcé ; toujours crédité en heures, son alimentation passerait ainsi à 35 heures par an dans la limite de 500 heures (au lieu de 24 heures puis 12 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 150 heures) ; en outre, les heures inscrites sur le CPF pourraient être abondées notamment dans le cadre d’un co-investissement défini et construit avec l’entreprise ou d’un accord de branche ; par ailleurs, le système des listes paritaires de formations éligibles au CPF serait supprimé et seules les certifications inscrites au RNCP (répertoire national de la certification professionnelle, en cours de refonte) et les formations permettant d’obtenir des blocs de compétences correspondant seraient éligibles ; enfin, un CPF “transition professionnelle” serait instauré et intégrerait une partie des droits liés au congé individuel de formation, qui pourrait être supprimé ;
– le plan de formation serait refondu et deviendrait le plan d’adaptation et de développement des compétences ; lors de son établissement, toujours soumis à la consultation des représentants du personnel, l’employeur n’aurait plus à faire la distinction entre les actions d’adaptation au poste de travail et de maintien dans l’emploi et celles de développement des compétences ; l’action de formation serait en outre redéfinie comme le processus pédagogique d’apprentissage par lequel tous les moyens (sous quelque forme que ce soit) sont déployés au regard de la situation de la personne pour lui permettre d’adapter, d’acquérir ou de développer des compétences professionnelles ou d’obtenir une qualification ;
– la formation en alternance reposerait toujours sur la distinction entre les contrats de professionnalisation et d’apprentissage qui serait conservée ; toutefois, une gouvernance unique par les branches professionnelles et des modalités communes (modèle, procédure, régime de rupture) seraient mises en œuvre ; par ailleurs, l’alternance serait financée par une seule et même contribution prélevée sur la contribution unique consacrée à la formation professionnelle ;
– la formation professionnelle dans sa globalité serait financée par une contribution unique et obligatoire, dont le montant serait égal à 1,23 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 1,68 % pour celles atteignant ou dépassant cet effectif ; parallèlement, la taxe d’apprentissage serait supprimée ; en pratique, le niveau de prélèvement des entreprises en matière de formation serait donc inchangé ;
– la prestation du conseil en évolution professionnelle serait consolidée afin de mieux accompagner les salariés dans la construction de leur parcours professionnel et bénéficierait d’un financement dédié à hauteur de 2,75 % de la contribution unique.
Le projet de la ministre du travail
Dans son discours, la ministre du travail, Muriel Pénicaud, a présenté les grandes lignes de son projet :
– le compte personnel de formation serait alimenté en euros (et non plus en heures de formation) à hauteur de 500 € par an dans la limite d’un plafond de 5 000 € au bout de 10 ans pour un salarié à temps plein ; ce crédit serait majoré pour les salariés peu qualifiés (800 € par an dans la limite de 8 000 €) ; le compte d’un travailleur en contrat à durée déterminée serait proratisé, mais pas celui du salarié à temps partiel (mi-temps ou plus) qui aurait un crédit identique à celui accordé à un salarié à temps plein ; par ailleurs, comme l’ANI, le projet gouvernemental prévoit la création d’un CPF de transition pour les formations longues ;
– le plan de formation de l’entreprise serait simplifié conformément aux souhaits des partenaires sociaux présentés ci-dessus ;
– l’employeur ne paierait plus qu’une seule contribution pour la formation continue et l’alternance comme le prévoient également les organisations syndicales et patronales dans leur accord (voir ci-dessus) ; mais le rôle de collecte de cette nouvelle cotisation relèverait de l’Urssaf et non plus des organismes collecteurs paritaires agrées ; ces derniers deviendraient alors des opérateurs de compétences chargés d’assister les entreprises et les branches professionnelles à anticiper la transformation des métiers, bâtir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et construire leur plan de formation ;
– la gouvernance nationale paritaire de la formation serait profondément réformée ; en pratique, les multiples instances actuelles, à savoir le FPSPP, le Cnefop et le Copanef, seraient regroupées en une agence nationale unique, dénommée France Compétences, qui serait chargée de réguler le prix et la qualité des formations et d’assurer la péréquation interprofessionnelle en matière d’alternance et de formation des petites et moyennes entreprises.
La médiation professionnelle pour mettre un terme aux conflits
La justice prédictive
Colloque organisé à l’occasion du bicentenaire de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
La justice prédictive
Cour de cassation, Lundi 12 février 2018
Intervention de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État
La justice a toujours été confrontée à de multiples défis : celui de son indépendance, celui de son efficacité et de sa qualité, celui de ses ressources, celui des technologies de l’information… Certains ont été surmontés, d’autres demeurent, parfois sous d’autres formes. De nouveaux défis, inédits et passionnants, se présentent aujourd’hui à nous et annoncent peut-être le bouleversement de l’accès au juge et de son office, comme des méthodes de travail des magistrats, greffiers et auxiliaires de justice. Après l’essor d’internet et de la dématérialisation, l’open data des décisions de justice[2], couplé au développement des algorithmes et de l’intelligence artificielle, soumettent en effet le juge à un défi nouveau : celui de la justice prédictive, qui doit s’inscrire au cœur de notre réflexion prospective, de nos projets et de notre vigilance.

I. La justice prédictive est porteuse de transformations majeures, mais ambivalentes.
A. Elle promet certes des évolutions bénéfiques pour la qualité et l’efficacité de la justice.
1. Les algorithmes prédictifs, fondés sur l’ouverture progressive, mais massive et gratuite des bases de jurisprudence à tous – l’open data –, visent à accélérer le règlement des litiges et à accroître la sécurité juridique, en améliorant la prévisibilité des décisions de justice. En effet, par leur utilisation les juges connaîtront mieux les pratiques juridictionnelles de leurs collègues et les parties pourront déterminer plus précisément les chances de succès d’une procédure juridictionnelle, ainsi que les moyens les plus pertinents à soulever. En retour, le couple open data/algorithmes devrait favoriser l’accès au droit et l’égalité devant la justice ainsi que la stabilisation, l’harmonisation et la convergence de la jurisprudence. Il est certes des méthodes plus classiques et tout aussi efficaces pour parvenir à cette fin. Mais l’unité et la cohérence de la jurisprudence peuvent, c’est vrai, gagner aux développements technologiques prévisibles à court terme.
2. Le recours à des algorithmes pour le traitement des dossiers les plus répétitifs et les plus simples, ceux par exemple qui ne nécessitent que l’évaluation d’un dommage, l’application d’un barème ou d’une trame prédéterminée, encouragerait aussi le règlement de nombreux litiges en amont même du recours au juge, par le développements des modes alternatifs de règlement, comme la médiation ou la conciliation. En réduisant le temps passé aux recherches fines fondées sur des éléments de fait et de droit comparables, l’utilisation des algorithmes permettrait également aux juges de se décharger des tâches les plus chronophages au profit de l’examen des questions nouvelles ou complexes[3]. Il en résulterait, selon les cas, un évitement du recours à la justice lorsque le résultat est certain ou un allègement de son travail. La justice prédictive favoriserait ainsi le recentrage des juges sur les dossiers pour lesquels leur expertise apporte une plus grande valeur ajoutée.
Il découlerait de ces évolutions une plus grande confiance dans la justice, les jugements pouvant être purgés de leur part d’aléa et les juges étant libérés de tâches répétitives ou moins complexes, le tout au profit d’une justice plus rapide, sûre et efficace[4].
B. Les progrès de la technologie ne doivent cependant pas masquer des risques pour l’office du juge et l’accès à la justice.
1. D’une part, le risque des logiciels prédictifs est que le juge, sous l’effet de la surveillance résultant d’un traitement massif des décisions de justice, perde sa liberté d’appréciation et son indépendance et préfère se ranger, par « sécurité », à l’opinion dominante ou majoritaire de ses pairs. Or, le propre de la justice est que chaque affaire soit examinée pour ce qu’elle est, avec sa part d’originalité et d’irréductible complexité qui ne saurait être systématisée par un logiciel, aussi puissant soit-il. Même dans un contentieux de masse ou très répétitif, l’expérience et la capacité personnelles et professionnelles des juges sont essentielles. Or, les algorithmes sont programmés pour réaliser des tâches ciblées, à partir d’un large vivier de données[5]. Ils ne le sont pas pour répondre à des questions ouvertes, ni pour définir de leur propre initiative les questions juridiques qui se posent, au moins indirectement ou par rebond. Ce que le juge comprend de la hiérarchie des normes et des relations entre les ordres juridiques nationaux et européens, un algorithme ne semble pas pouvoir en l’état le saisir. C’est pourquoi le juge doit rester maître de la question posée autant que de l’interprétation du résultat donné par les algorithmes et des conséquences à en tirer[6].
2. D’autre part, si la prévisibilité du droit est nécessaire, elle ne doit pas figer la jurisprudence. Parce que les avocats sauront plus sûrement demain quels sont les moyens fondés ou pas, et parce que les juges pourraient être dissuadés de s’écarter de la tendance majoritaire des décisions de justice, les résultats produits par les algorithmes risquent d’être répétés et amplifiés et toute décision « atypique », même justifiée, risquera de paraître inacceptable, si elle n’est pas spécialement et très fortement motivée[7]. Les algorithmes risquent ainsi de cristalliser la jurisprudence, alors que celle-ci doit au contraire être non pas rétrospective, mais apporter une solution concrète à un litige présent et, plus largement, accompagner les évolutions législatives, économiques et sociales. Ils risquent en outre de conférer une force excessive à des solutions majoritaires, mais pas forcément pertinentes : le nombre est une chose, la justice en est une autre. Lorsque l’on connaît le rôle que la jurisprudence administrative a joué dans la construction et l’adaptation du droit administratif français, on frémit à l’idée que des algorithmes puissent brider la liberté du juge et l’on en vient à s’interroger sur leur pertinence même.
3. Enfin, s’il est vrai que la « prescience » des algorithmes prédictifs pourrait permettre d’éviter une longue et coûteuse procédure dans un litige dont la part d’aléa paraît réduite, l’accès au juge et les principes du procès équitable doivent rester la règle. Le recours au règlement alternatif des litiges doit être encouragé lorsqu’il est possible, mais il ne saurait faire obstacle au procès. En outre, comme toutes les probabilités, les résultats proposés par les algorithmes surtout dans des configurations ouvertes et non pas fermées, comme le jeu de gô ou les échecs, comportent une part d’aléa et le recours au juge ne doit pas être dissuadé sur la base de données qui ne seraient pas entièrement fiables et qui pourraient même être biaisées.
II. L’open data et la justice prédictive promettent des progrès dont nous devons nous saisir, mais dans le respect des principes fondamentaux de la justice.
Quelques principes directeurs doivent guider notre réflexion et notre action sur ce sujet qui s’impose en tout état de cause à nous et que nous ne saurions par conséquent éluder.
A. Les juges doivent conserver leur liberté d’appréciation et leur indépendance.
Le développement des algorithmes prédictifs ne doit pas aboutir à ce que l’intelligence artificielle se substitue, à terme, à l’analyse juridique et au raisonnement personnel du juge. Ce dernier doit continuer à exercer ses fonctions en toute indépendance en appliquant au litige dont il est saisi les textes et la jurisprudence pertinents et il doit le faire en considération des faits et circonstances propres à chaque affaire dans le cadre d’un débat qui doit, même en visioconférence ou en mode virtuel, rester public et contradictoire et qui pourra d’ailleurs être plus aisément accessible et archivé. Si, dans un souci de sécurité juridique, il faut éviter la méconnaissance ou les revirements aléatoires de la jurisprudence, l’analyse statistique et algorithmique ne saurait être un prétexte à des comportements mimétiques irréfléchis[8]. L’intelligence artificielle et l’intelligence humaine doivent se combiner et se renforcer mutuellement, la première ne pouvant prétendre remplacer l’autre, comme le souligne à juste titre M. Cédric Villani[9]. L’adossement à l’intelligence humaine est d’autant plus essentiel que le taux actuel de sûreté des algorithmes prédictifs en droit ne semble pas, en l’état, excéder 70%, ce qui n’est pas si élevé et ne saurait fonder des certitudes[10]. Le risque mimétique que j’évoque est à ce stade limité, l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 interdisant en principe de se fonder sur des traitements automatisés pour établir le profil d’une personne et rendre une décision[11]. Le juge peut toutefois dès maintenant prendre appui sur des statistiques pour étayer et légitimer un raisonnement juridique adossé à d’autres justifications[12].
B. L’utilisation des algorithmes doit être fondée sur les principes de neutralité et de transparence.
1. La neutralité des algorithmes ne saurait être présumée. Chaque jour qui passe nous révèle au contraire les présupposés dont ils sont porteurs. Il a ainsi été démontré que les algorithmes utilisés pour calculer le risque de récidive des prévenus reproduisent les biais ou préjugés sociaux de leurs concepteurs[13]. Les résultats proposés par les logiciels prédictifs ne se bornent pas en effet à fournir une information désincarnée ; ils agissent comme un signal : celui d’une tendance ou d’une interprétation majoritaire, qui a ensuite vocation à influencer le processus décisionnel. Il faut être lucide sur le fait que le recours aux algorithmes risque d’être performatif ou auto-réalisateur, voire carrément perturbateur, comme on l’observe sur les marchés financiers ou ceux des obligations depuis le début de ce mois. Il en résulte que la méthodologie retenue dans le traitement des données disponibles en open data doit être explicite et transparente[14], pour que les utilisateurs puissent comparer et discuter les résultats et obtenir des explications sur les différences, voire les erreurs ou les biais, qu’ils pourraient constater. En particulier, il est essentiel que le juge et les parties puissent débattre du contenu et des résultats des algorithmes – ceux qui suggèrent des rédactions et, plus encore, ceux qui proposent des solutions – pour être en mesure de ne pas subir passivement leurs résultats, le cas échéant. La traçabilité et la régulation des algorithmes doivent aussi être, dans toute la mesure du possible, assurées ou du moins sérieusement recherchées.
2. Il faut également veiller à la neutralité et la complétude des sources jurisprudentielles mobilisées dans le cadre de l’usage des algorithmes. Dès maintenant, apparaissent des asymétries problématiques entre les parties que le juge n’est pas toujours en mesure de corriger. C’est le cas dans certains litiges relevant du droit de la consommation, pour la résolution desquels apparaissent des biais dans la sélection des décisions jurisprudentielles de référence. L’impact de ces biais est potentiellement d’autant plus important que le règlement du litige est pré-juridictionnel.
C. Enfin, pour que les juges et les avocats puissent continuer à se repérer dans des informations même exhaustives et interactives, il est nécessaire de conserver une certaine hiérarchisation de la jurisprudence.
L’open data a tendance à araser toute différence entre les niveaux des décisions de justice, à remettre en cause toute hiérarchie entre les différentes formations de jugement. Tout serait égal et tout se vaudrait. Or les arrêts des formations supérieures viennent poser, dans une navigation juridictionnelle parfois périlleuse, des phares et des balises aidant au repérage que la multitude des décisions d’espèce ne doit pas masquer[15]. Il est donc important de maintenir une véritable hiérarchie des décisions en fonction des formations de jugement, si possible en première instance, mais aussi en appel et au sein des juridictions suprêmes. Cet aspect demeure essentiel.
La justice prédictive arrive à grands pas, sans être encore, il faut le reconnaître, pleinement opérationnelle et sûre. Mais les choses pourraient vite changer. C’est donc maintenant qu’il faut réfléchir aux chances et aux risques qu’elle comporte, comme aux conditions impératives de son développement. Celui-ci est déjà en cours avec les Legal Tech et il ne saurait être regardé a priori comme une régression indéfendable. Nous devons accepter cette réalité, nous saisir de ces opportunités, tout en sachant faire preuve d’une grande vigilance sur l’intangibilité des principes d’une justice indépendante, impartiale, transparente, humaine et équilibrée, qui se garde de tout automatisme et de tout psittacisme et qui ne soit pas dépendante de modèles économiques ou de plans d’affaires respectables mais ni désintéressés, ni neutres. Il nous faut aussi, à l’occasion du développement de la justice prédictive, nous interroger sur l’extension possible du périmètre du service public de la justice en amont de la saisine du juge (au stade du règlement pré-juridictionnel) et en aval de sa décision (au stade de l’exécution)[16]. Et aussi sur le mode de gestion de ce service public additionnel. En faisant progresser la réflexion sur ces sujets qui donnent quelque peu le vertige, les juges et les juristes pourront éclairer la prise de décision publique pour que les évolutions en cours soient maîtrisées et que les juges, comme les parties au litige, puissent s’en servir sans y être asservies. Au contraire, si nous pratiquons la politique de l’autruche, ces évolutions se feront sans nous et le résultat pourrait bien plus que nous déplaire : il pourrait mettre notre justice en péril. C’est pourquoi ce colloque est une excellente opportunité pour dresser des constats, esquisser des diagnostics et proposer des orientations, des remèdes ou des limites. Je remercie vivement l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et son président Maître Louis Boré, d’avoir pris l’heureuse initiative de cette réflexion et la Cour de cassation d’avoir bien voulu l’accueillir.
[1] Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.
[2]Articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui prévoient que toutes les décisions de justice doivent être mises à disposition du public à titre gratuit.
[3] T. Cassuto, « La justice à l’épreuve de sa prédictibilité », AJ Pénal, 2017, p. 334. Voir aussi les propos de Cédric Villani rapporté par L. Ronfaut dans l’article « Cédric Villani avance sur l’intelligence artificielle », Le Figaro, 29 novembre 2017.
[4] A. Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G., 9 janvier 2017, doctr. 31.
[5] C. Villani dans une interview au Figaro, 19 janvier 2018, « L’Europe peut relever le défi de l’intelligence artificielle ».
[6] F. Rouvière, « La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal », RTD Civ., 2017, p. 527.
[7] E. Buat-Ménard et P. Gambiasi, « La mémoire numérique des décisions judiciaires. L’open data des décisions de justice de l’ordre judiciaire », Recueil Dalloz, 2017, p. 1483.
[8] Voir sur ce point l’article d’A. Garapon, op.cit. note 4, p. 31.
[9] C. Villani dans une interview au Figaro, 19 janvier 2018, « L’Europe peut relever le défi de l’intelligence artificielle ».
[10] Rapport de l’Institut Montaigne, Justice : faites entrer le numérique, novembre 2017 p. 42.
[11] Article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. / Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. (…) »
[12] Voir sur ce point CE, 4 février 2004, Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, n° 240023 : si la loi du 6 janvier 1978 fait obstacle à ce qu’une décision de justice soit fondée uniquement sur le traitement automatisé d’information, le juge peut recourir à ces éléments, parmi d’autres éléments d’appréciation, pour éclairer sa réflexion.
[13] P. Cornille, « Justice prédictive : est-ce un oxymore ? », AJFI, juillet 2018, repère 7.
[14]Rapport de la mission d’étude et de préfiguration de l’ouverture au public des décisions de justice, L’open data des décisions de justice, remis à la Garde des sceaux, ministre de la justice en novembre 2017, recommandation n° 20, p. 25.
[15] Voir sur ce sujet l’article de J-H. Stahl, « “Open data” et jurisprudence », Droit administratif, novembre 2016, Repère 10.
[16] Rapport de l’Institut Montaigne, Justice : faites entrer le numérique, novembre 2017 p. 51.
Présentation des services de la Médiation Professionnelle pour les établissements de santé
Rima Conseils et Services est une entreprise de conseil, qui a une compétence spécifique en matière de médiation professionnelle dans le cadre de la résolution de conflits pour y mettre un terme.

Cette technique de résolution des conflits est recommandée dans :
- La gestion et résolution des conflits au niveau DRH :
Comme le précise « La stratégie nationale d’amélioration de la qualité au travail
Ces textes affirment le développement de la qualité de vie au travail comme une politique prioritaire.
Le texte de 2016 prévoit la nomination d’un médiateur national. Celui-ci propose un système articulé autour d’initiatives locales de prévention et la résolution des conflits.
« La mise en place de conciliations locales et de médiations doit permettre d’intervenir sur les conflits afin d’éviter leur aggravation et leurs conséquences en termes de risques psycho-sociaux » précise Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de La Santé.
- La résolution de conflits réalisée dans le cadre de la commission des usagers (CDU ou CRU décret n°2016-726 du 1er juin 2016 ) entre les établissements de santé et les usagers.
Le médiateur professionnel, Richard SADOWSKI, membre de la Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation, intervient lorsqu’il est sollicité afin de rétablir une qualité de communication : c’est un expert en qualité relationnelle ; il instaure un dialogue lorsqu’une relation s’est dégradée voire est devenue conflictuelle. https://rimacs.fr/la-mediation-professionnelle
À l’opposé d’un médiateur médical ou paramédical, professionnels de l’établissement, la posture du médiateur est celle de la neutralité, l’impartialité et de l’indépendance, il n’a aucun besoin de consulter le dossier du patient.
La médiation permet d’agir sur la perte de confiance ressentie par l’usager, de la restaurer et d’instaurer à nouveau un climat de confiance propice à l’écoute de l’autre.
La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des patients, a institué, par l’article L 1112-3 al 2 l’obligation pour chaque établissement de santé de mettre en place une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC).
Cette commission des relations avec les usagers s’est substituée à la commission de conciliation déjà en place dans tous les établissements de santé.
Le décret d’application N° 2005-213 du 2 mars 2005 a précisé les règles de fonctionnement de cette nouvelle commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, en prévoyant la nomination d’un médiateur médecin et d’un médiateur non médecin parmi le personnel de chaque établissement de santé.
C’est ainsi, qu’à partir de 2005, les termes « médiation » et « médiateur » ont fait leur apparition au sein des hôpitaux. Largement justifiée par la montée en puissance des plaintes et réclamations, démontrant, la nécessité du développement de la Médiation Professionnelle au sein des établissements de santé.
Hôpitaux : des médiateurs seront opérationnels fin 2018 début 2019 pour gérer les harcèlements et conflits professionnels
Dans les hôpitaux, il y a de nombreux cas de harcèlement et de conflit professionnel non résolus. Le gouvernement souhaite mettre un terme à cette loi du silence en instaurant des médiateurs régionaux pour arbitrer les conflits professionnels internes.
Pour arbitrer les cas de conflits professionnels au sein des hôpitaux, le médiateur national Édouard Couty vient d’annoncer la mise en place de médiateurs régionaux qui seront formés et « opérationnels » d’ici la fin de l’année. Le point sur cette annonce.

Mise en place de conciliations locales et de médiations au niveau régional et national
C’est la mission qui a été donnée à Édouard Couty par l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine — et confirmé à son poste par Agnès Buzyn — lors de sa nomination en janvier 2017. Il a annoncé lors d’un colloque sur la maltraitance et le harcèlement à l’hôpital « Nous pourrons mettre en place pendant l’automne les structures régionales et être opérationnels fin 2018, début 2019 ».
Un décret attendu cet été
Un décret est attendu dans le courant de l’été pour définir le cadre de la médiation à l’hôpital, notamment « les règles de saisine », a précisé l’ancien directeur des hôpitaux. Il a également précisé que les futurs médiateurs régionaux devront recevoir une « formation certifiante ».
Arbitrer les conflits entre pairs et avec la hiérarchie
En un an, le médiateur national est intervenu dans 53 dossiers, dont 49 cas de médecins en conflit avec leurs pairs ou leur hiérarchie.
« L’omerta à l’hôpital est en train de tomber », a dit M. Couty, précisant que la médiation « n’est pas un gadget, elle répond à un besoin ». Il a ajouté « Il y a une culture paternaliste dans cette institution », mais « l’infantilisation des subordonnés est de moins en moins supportée ».
source Par DemarchesAdministratives.fr avec AFP, mis à jour le , publié le .
LA MEDIATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU DES ETABLISEMENTS DE SANTE
La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des patients, a institué, par l’article L 1112-3 al 2 l’obligation pour chaque établissement de santé de mettre en place une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC).
Cette commission des relations avec les usagers s’est substituée à la commission de conciliation déjà en place dans tous les établissements de santé.
Le décret d’application N° 2005-213 du 2 mars 2005 a précisé les règles de fonctionnement de cette nouvelle commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, en prévoyant la nomination d’un médiateur médecin et d’un médiateur non médecin parmi le personnel de chaque établissement de santé.
C’est ainsi, qu’à partir de 2005, les termes « médiation » et « médiateur » ont fait leur apparition au sein des hôpitaux. Largement justifiée par la montée en puissance des plaintes et réclamations, démontrant, la nécessité du développement de la Médiation Professionnelle au sein des établissements de santé.

QUEL SONT LES PROBLÈMES RENCONTRES ?
Usagers / Institution
En effet, les médiateurs qui agissent dans les établissements sont par ailleurs impliqués dans la vie hospitalière et médicale. Inévitablement et légitimement, ils sont amenés à examiner les plaintes et réclamations qui leur sont soumises sous l’angle de leur environnement professionnel.
Dès lors, il est fondé de s’inquiéter de la réalité de leur neutralité quant à la solution et de leur impartialité dans leur relation avec les parties.
Cette appartenance au corps médical et hospitalier permet plus légitimement encore, et les usagers ne manquent pas de l’évoquer, de mettre en cause leur réelle indépendance. Cela pose une difficulté évidente quant à la position du personnel hospitalier par rapport à sa hiérarchie, lorsqu’il est amené à agir en médiateur.
Ces confusions, qui sont autant de risques pour les médiateurs hospitaliers, s’expliquent probablement par l’histoire de la Médiation Professionnelle dans le secteur hospitalier. En fait, peu familières des processus non administratifs et non directifs, les structures hospitalières ont simplement transposé les mécanismes de la conciliation, dans un nouveau dispositif en le renommant « médiation ».
En réalité, les méthodes de résolution des conflits n’ont pas été modifiées et c’est la confusion qui prévaut au sein des établissements de santé, la conciliation et l’arbitrage pratiqués en réalité étant bien souvent qualifiés abusivement de médiation.
Relations Inter personnelles
Les conflits inter personnels sont assez fréquents dans une communauté de travail. Certaines situations entre agents débouchent sur des conflits qui nuisent inéluctablement à la qualité du travail et à la relation d’équipe. Ces problèmes conflictuels, jusqu’alors gérés par l’autorité ou la direction, pas toujours efficacement, pourraient être désamorcés par l’intervention d’un tiers formé à la médiation et à la gestion des conflits avant de recourir à une autorité judiciaire. Ce d’autant que les conflits peuvent survenir entre l’agent et sa hiérarchie. Par ailleurs le temps consacré à la résolution de tels problèmes pèse sur l’efficacité des cadres ainsi que sur l’efficience générale d’un service. L’ambiance générale au travail pâtit fortement de ces dynamiques négatives.
Une rapide enquête auprès de l’encadrement rapporte la fréquence des résolutions de conflits auxquels ils sont confrontés, l’importance du temps consacré, les difficultés inhérentes à cette pratique et le « porte à faux » généré pour eux même dans leur dynamique managériale. Il est évident que les acteurs ou les témoins de conflits sont trop impliqués et mal placés pour les solutionner. Le recours à la Médiation Professionnelle dépasse le champ de la résolution de conflit pour investiguer la prévention de ceux-ci.
En effet, les situations de ce type sont la résultante évolutive de tensions, d’oppositions, de confusions, de sentiments d’injustice. Elles constituent des impasses à la discussion et au retour au consensuel.
Utiliser l’outil de la Médiation Professionnelle en amont des conflits apporte une efficacité accrue car elle agit avant la dramatisation, la colère, l’incompréhension : « dénouer un nœud en train de se serrer ».
La médiation au sein des établissements de santé
Les directions des établissements de santé, le personnel d’encadrement ont dû faire appel à des Médiateurs Professionnels, formés aux techniques de pacification relationnelle et d’amélioration de la communication entre les personnes.
La posture du médiateur professionnel permet la maîtrise d’un processus structuré et la mise en application de techniques spécifiques dans le cadre d’une résolution de conflits.
Ce processus inversé, eu égard les méthodes juridiques de règlement des litiges, consiste à épurer d’abord l’émotionnel, notion essentielle face à laquelle le personnel hospitalier est confronté en permanence, avant de s’intéresser aux aspects techniques du problème.
Les parties, ainsi allégées de cette surcharge affective, seront aptes à négocier et élaborer elles-mêmes une solution qui leur conviennent.
Cette approche permet d’éviter la judiciarisation de nombreuses plaintes et réclamations relevant simplement de la pression émotionnelle et de la difficulté des personnes à maîtriser leur communication et son impact dans certaines situations qui les affectent tout particulièrement.
L’intégration de la Médiation Professionnelle en tant que discipline à part entière dans tous les établissements de santé peut à elle seule permettre d’accompagner les parties vers une réflexion « en altérité », ce qui permet, entre autres, de reconnaître la légitimité des points de vue. À la différence de l’adversité qui emmène inévitablement les parties vers des procédures longues et coûteuses.

La Médiation Professionnelle repose sur un processus basé sur le respect des quatre fondamentaux du code éthique et déontologique :
L’indépendance (tutélaire ou culturelle)
La neutralité (quant à la solution)
L’impartialité (vis-à-vis des parties)
La confidentialité (à l’égard des tiers)
Il est aujourd’hui indiscutable que la Médiation Professionnelle a toute sa place au sein du système hospitalier. Elle peut se décliner non seulement dans l’application du décret cité plus haut mais peut également intervenir dans 3 grands domaines distincts dans l’accompagnement des prises de décisions et de changements :
1) les relations patients, usagers / institutions
Plaintes et réclamations
Relations au quotidien (assistants sociaux, service des urgences, bloc opératoire…)
2) les ressources humaines
Les relations conflictuelles au travail (harcèlement, dégradation relationnelle…)
Les souffrances au travail, etc.
3) l’accompagnement au changement
Coopération clinique privée / hôpitaux publics
Mise en place de la nouvelle gouvernance
Mandat social et activité libérale au sein d’une SEL : conséquences fiscales du cumul
Le président d’une société d’exercice libéral exerçant une activité professionnelle libérale au sein de la société peut déduire les cotisations d’assurance « Madelin » des rémunérations perçues au titre de cette activité si elles sont imposées comme des bénéfices non commerciaux.

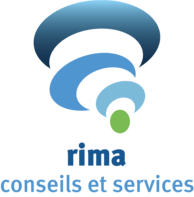
Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la nature des rémunérations perçues en cas de cumul entre un mandat social et une activité libérale au sein d’une société d’exercice libéral.
Il juge ainsi que, lorsque le président d’une Selafa ou d’une Selas exerce au sein de cette société, en plus de son mandat social, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations qu’il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux. Par conséquent, il peut déduire de ces rémunérations les cotisations d’assurance de groupe mentionnées à l’article 154 bis du CGI qu’il verse au titre de cette activité.
À noter : les titulaires de BIC et de BNC, d’une part, les dirigeants de sociétés mentionnés à l’article 62 du CGI, qui perçoivent en cette qualité des rémunérations imposées d’après les règles des traitements et salaires, d’autre part, peuvent, en vertu de l’article 154 bis du CGI, déduire des revenus qu’ils tirent de leur activité professionnelle les cotisations versées au titre de contrats d’assurance de groupe. En revanche, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, le président d’une SA, d’une SAS ou d’une société constituée sous ces formes pour l’exercice d’une profession libérale ne peut pas déduire ces cotisations des sommes qu’il perçoit en contrepartie de l’exercice de son mandat, qui relèvent de la catégorie des salaires.
Que se passe-t-il lorsque le président d’une Selafa (société d’exercice libéral à forme anonyme) ou d’une Selas (société d’exercice libéral par actions simplifiée) exerce au sein de cette société, en plus de son mandat social, une activité professionnelle ?
En l’espèce, le contribuable exerçait au sein d’une Selas exploitant un laboratoire d’analyses médicales à la fois des fonctions non rémunérées de président du conseil d’administration et une activité libérale de directeur de laboratoire pour laquelle il était rémunéré. La cour administrative d’appel avait requalifié les rémunérations perçues en traitements et salaires, et donc exclu la déductibilité des cotisations, au seul motif que la rémunération des dirigeants de SAS relevait de la catégorie des traitements et salaires.
Censure du Conseil d’État qui juge que la cour aurait dû rechercher si le contribuable exerçait son activité professionnelle au sein de la société dans des conditions traduisant un lien de subordination.
CE 8-12-2017 no 409429
